Urgence climatique : quelles solutions pour éviter le pire ?
Le réchauffement climatique augmente significativement depuis vingt ans, mais en 2021, il s’est nettement accéléré. Les précipitations intenses, les canicules, les cyclones tropicaux, se sont renforcés. Les effets de ces phénomènes extrêmes sont dévastateurs pour l’environnement et impactent des millions de personnes à travers le monde. D’après le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) élaboré par 234 scientifiques de 66 pays, l’influence humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent depuis au moins 2000 ans.
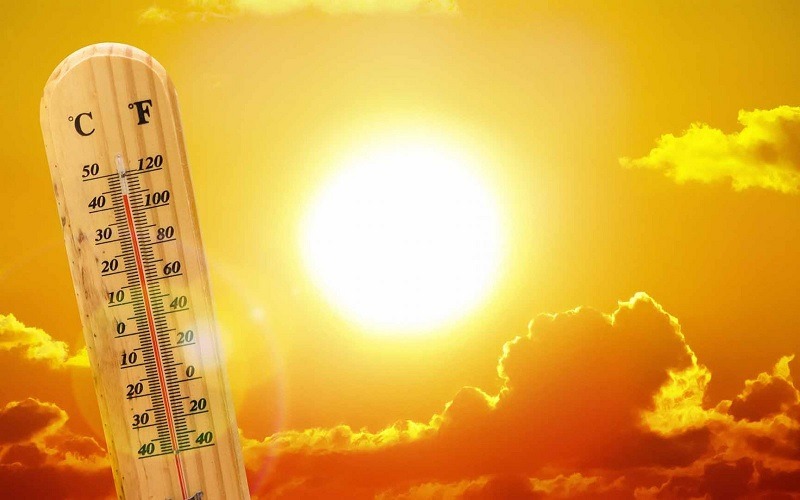
Lors de la COP 26 qui s’était tenue du 1er au 13 novembre dernier à Glasgow en Ecosse, au Royaume-Uni, une centaine de pays représentant 85% des forets du monde s’étaient officiellement engagés à enrayer la déforestation d’ici 2030. Parmi les territoires concernés, la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne mais aussi la forêt d’Afrique Centrale (qui absorbe plus de carbone qu’elle n’en rejette). En effet la déforestation augmente ces dernières années, et elle a pris une très grande ampleur en 2021. Les feux de forêt se sont multipliés, surtout au Brésil. Au mois de juin dernier, 2308 foyers d’incendie ont été détectés par les satellites de l’Institut national de la recherche spatiale (INPE), un record depuis les feux historiques de 2007, une catastrophe pour notre planète.

LES CAUSES DE LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES
La pression démographique entraîne une explosion de l’exploitation des ressources forestières. En Amazonie, la déforestation est principalement due à l’agriculture industrielle avec des forêts de végétation variée qui sont entièrement remplacées par des forêts d’hévéas ou de sojas. En Afrique, elle est due à l’agriculture sur brûlis. C’est un mode de fonctionnement agraire qui consiste à défricher des parcelles par le feu. Celles-ci sont ensuite utilisées pour la culture de subsistance avant d’être laissées en friche. Il y a aussi l’exploitation du charbon de bois, une des pratiques nécessaires pour la vie de ces populations.

L’augmentation de la température à la surface de la terre est due à l’effet de serre artificiel provoqué par les gaz rejetés dans l’atmosphère tels que le CO2, le méthane (2e cause des GES, rejeté par l’élevage intensif). Il est différent de l’effet de serre naturel. Lorsque la terre est éclairée par le soleil, sa surface émet à nouveau vers l’espace une partie du rayonnement qu’elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre comme le CO2, le méthane ou le protoxyde d’azote retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la terre et la lui renvoie, ce qui la fait réchauffer. Cette chaleur émise naturellement est indispensable à la vie humaine.
L’homme a déréglé ce mécanisme par la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, la déforestation et l’agriculture intensive. Ces gaz s’accumulent dans l’atmosphère et le surplus d’énergie introduit dans le climat par l’action de l’homme a des conséquences dramatiques : fonte des glaces, élévation des océans, augmentation des précipitations. Mais aussi l’acidification des océans (le CO2 excédentaire se dissout dans les hautes surfaces et les rend plus acides).

DES INITIATIVES POUR CHANGER LES CHOSES
Pour limiter les effets néfastes de l’augmentation des températures, les gouvernements essaient de s’adapter au changement climatique que notre mode de vie a fini par créer. Ils mettent en place des politiques visant à protéger les populations et la nature contre les menaces potentielles liées au réchauffement climatique (en utilisant par exemple des énergies renouvelables). La séquestration de CO2 est aussi une solution. Il consiste à récupérer du CO2 en excès dans l’atmosphère et de le stocker dans la nature. Des mesures d’atténuation, comme remplacer les voitures à carburant fossile par des voitures à carburant électrique peuvent être aussi prises.
Dans beaucoup de pays, on parle aussi de neutralité carbone. Il est défini comme l’équilibre entre les émissions de carbone et son absorption par les puits de carbone (forets, sols ou océans). Atteindre cette neutralité signifie rejeter autant de carbone que l’on en absorbe, que ce soit par des moyens naturels ou technologiques, mais cela nécessite des investissements colossaux. De nombreux accords sont signés sans pour autant être ratifiés…
Les Contributions déterminées au Niveau national (CDN) correspondent aux engagements pris par chacun des 196 des pays signataires de l’accord de Paris, qui vise à contenir le réchauffement climatique dans une fourchette entre 1,5 et 2 degrés Celsus d’ici 2100 par rapport aux niveaux préindustriels (milieu du XIXe siècle). Engagements dont on sait aujourd’hui qu’ils seront intenables, compte tenu de l’accélération du réchauffement climatique actuel. Les experts évoquent des températures à la surface de la terre en augmentation de + 6° à + 7° Celsus en 2100.
LE RÔLE DU GIEC
Le Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un organe scientifique crée par le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) en 1988. Il détermine les causes et conséquences du changement climatique, établit des scénarios possibles et évalue les possibilités pour limiter l’ampleur de la crise. Ses rapports font la synthèse des connaissances scientifiques sur l’évolution du climat. Ils servent de base aux Etats pour établir leurs politiques climatiques et pour débattre lors des grandes réunions internationales.

Commentaires